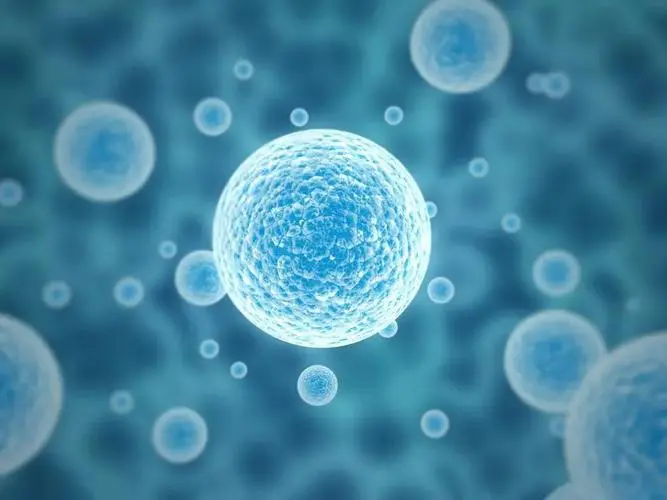L'oxygénothérapie est l'une des méthodes les plus couramment utilisées en médecine moderne, mais il existe encore des idées fausses sur les indications de l'oxygénothérapie, et une mauvaise utilisation de l'oxygène peut provoquer de graves réactions toxiques.
Évaluation clinique de l'hypoxie tissulaire
Les manifestations cliniques de l'hypoxie tissulaire sont variées et non spécifiques, les symptômes les plus marquants étant la dyspnée, l'essoufflement, la tachycardie, la détresse respiratoire, les changements rapides de l'état mental et l'arythmie. Pour déterminer la présence d'une hypoxie tissulaire (viscérale), le lactatémie (élevée en cas d'ischémie et de diminution du débit cardiaque) et la SvO2 (diminuée en cas de diminution du débit cardiaque, d'anémie, d'hypoxémie artérielle et d'hypertrophie métabolique) sont utiles à l'évaluation clinique. Cependant, le lactatémie peut être élevée en conditions non hypoxiques ; le diagnostic ne peut donc pas être posé uniquement sur la base de cette élévation, car elle peut également être élevée en cas d'hyperglycémie, comme la croissance rapide de tumeurs malignes, un sepsis précoce, des troubles métaboliques et l'administration de catécholamines. D'autres valeurs biologiques indiquant un dysfonctionnement organique spécifique sont également importantes, comme une augmentation de la créatinine, de la troponine ou des enzymes hépatiques.
Évaluation clinique de l'état d'oxygénation artérielle
Cyanose. La cyanose est généralement un symptôme qui survient au stade avancé de l'hypoxie. Elle est souvent peu fiable pour diagnostiquer l'hypoxémie et l'hypoxie, car elle peut ne pas survenir en cas d'anémie ou de mauvaise perfusion sanguine. De plus, elle est difficile à détecter chez les personnes à la peau foncée.
Surveillance par oxymétrie de pouls. La surveillance non invasive par oxymétrie de pouls est largement utilisée pour le suivi de toutes les maladies, et sa SaO₂ estimée est appelée SpO₂. Le principe de la surveillance par oxymétrie de pouls est la loi de Bill, qui stipule que la concentration d'une substance inconnue dans une solution peut être déterminée par son absorption de lumière. Lorsque la lumière traverse un tissu, la majeure partie est absorbée par les éléments constitutifs du tissu et par le sang. Cependant, à chaque battement cardiaque, le sang artériel subit un flux pulsatile, ce qui permet à l'oxymètre de pouls de détecter les variations d'absorption lumineuse à deux longueurs d'onde : 660 nanomètres (rouge) et 940 nanomètres (infrarouge). Les taux d'absorption de l'hémoglobine réduite et de l'hémoglobine oxygénée sont différents à ces deux longueurs d'onde. Après soustraction de l'absorption des tissus non pulsatiles, on peut calculer la concentration d'hémoglobine oxygénée par rapport à l'hémoglobine totale.
La surveillance par oxymétrie de pouls présente certaines limites. Toute substance présente dans le sang absorbant ces longueurs d'onde peut perturber la précision de la mesure, notamment les hémoglobinopathies acquises (carboxyhémoglobine et méthémoglobinémie), le bleu de méthylène et certaines variantes génétiques de l'hémoglobine. L'absorption de la carboxyhémoglobine à une longueur d'onde de 660 nanomètres est similaire à celle de l'hémoglobine oxygénée ; elle est très faible à une longueur d'onde de 940 nanomètres. Par conséquent, quelle que soit la concentration relative d'hémoglobine saturée en monoxyde de carbone et d'hémoglobine saturée en oxygène, la SpO2 reste constante (90 % à 95 %). Dans la méthémoglobinémie, lorsque le fer hémique est oxydé à l'état ferreux, la méthémoglobine égalise les coefficients d'absorption des deux longueurs d'onde. Il en résulte une variation de la SpO2 comprise entre 83 % et 87 % seulement, dans une plage de concentrations de méthémoglobine relativement large. Dans ce cas, quatre longueurs d’onde de lumière sont nécessaires pour mesurer l’oxygène dans le sang artériel afin de distinguer les quatre formes d’hémoglobine.
La surveillance par oxymétrie de pouls repose sur un débit sanguin pulsatile suffisant. Par conséquent, elle ne peut être utilisée en cas d'hypoperfusion de choc ni lors de l'utilisation de dispositifs d'assistance ventriculaire non pulsatile (où le débit cardiaque ne représente qu'une faible proportion du débit cardiaque). En cas d'insuffisance tricuspidienne sévère, la concentration de désoxyhémoglobine dans le sang veineux est élevée, et la pulsation du sang veineux peut entraîner une faible saturation en oxygène du sang. En cas d'hypoxémie artérielle sévère (SaO2 < 75 %), la précision peut également diminuer, car cette technique n'a jamais été validée dans cette plage. Enfin, de plus en plus de personnes réalisent que la surveillance par oxymétrie de pouls peut surestimer la saturation en hémoglobine artérielle de 5 à 10 points de pourcentage, selon le dispositif utilisé par les personnes à la peau foncée.
PaO2/FIO2. Le rapport PaO2/FIO2 (communément appelé rapport P/F, compris entre 400 et 500 mm Hg) reflète le degré d'anomalie des échanges d'oxygène dans les poumons et est particulièrement utile dans ce contexte, car la ventilation mécanique permet de régler précisément la FIO2. Un rapport PA/F inférieur à 300 mm Hg indique des anomalies cliniquement significatives des échanges gazeux, tandis qu'un rapport P/F inférieur à 200 mm Hg indique une hypoxémie sévère. Les facteurs qui influencent le rapport P/F comprennent les réglages de ventilation, la pression expiratoire positive et la FIO2. L'impact des variations de la FIO2 sur le rapport P/F varie selon la nature de la lésion pulmonaire, la fraction de shunt et l'amplitude des variations de la FIO2. En l'absence de PaO2, la SpO2/FIO2 peut constituer un indicateur alternatif raisonnable.
Différence de pression partielle d'oxygène dans le sang artériel alvéolaire (Aa PO2). La mesure de la différence de PO2 dans le sang artériel alvéolaire est la différence entre la pression partielle d'oxygène dans le sang artériel alvéolaire calculée et la pression partielle d'oxygène dans le sang artériel mesurée. Elle permet de mesurer l'efficacité des échanges gazeux.
La différence « normale » de PO2 Aa pour l'air ambiant respiré au niveau de la mer varie avec l'âge, de 10 à 25 mm Hg (2,5 + 0,21 x âge [années]). Le deuxième facteur d'influence est la FIO2 ou la PAO2. Si l'un de ces deux facteurs augmente, la différence de PO2 Aa augmente également. En effet, les échanges gazeux dans les capillaires alvéolaires se produisent sur la partie la plus plate (pente) de la courbe de dissociation de l'oxygène de l'hémoglobine. À degré de mélange veineux égal, la différence de PO2 entre le sang veineux mixte et le sang artériel augmente. À l'inverse, si la PO2 alvéolaire est basse en raison d'une ventilation inadéquate ou d'une altitude élevée, la différence de PO2 Aa sera inférieure à la normale, ce qui peut entraîner une sous-estimation ou un diagnostic erroné de dysfonctionnement pulmonaire.
Indice d'oxygénation. L'indice d'oxygénation (IO) peut être utilisé chez les patients sous ventilation mécanique afin d'évaluer l'intensité de la ventilation assistée nécessaire au maintien de l'oxygénation. Il comprend la pression moyenne des voies aériennes (PMA, en cm H2O), la FIO2 et la PaO2 (en mm Hg) ou la SpO2. S'il dépasse 40, il peut servir de référence pour l'oxygénation par membrane extracorporelle. Valeur normale inférieure à 4 cm H2O/mm Hg ; en raison de la valeur uniforme de cm H2O/mm Hg (1,36), les unités ne sont généralement pas incluses dans ce rapport.
Indications de l'oxygénothérapie aiguë
Lorsque les patients éprouvent des difficultés respiratoires, une supplémentation en oxygène est généralement nécessaire avant le diagnostic d'hypoxémie. Lorsque la pression partielle artérielle en oxygène (PaO₂) est inférieure à 60 mm Hg, l'indication la plus évidente d'une consommation excessive d'oxygène est l'hypoxémie artérielle, qui correspond généralement à une saturation artérielle en oxygène (SaO₂) ou périphérique (SpO₂) de 89 % à 90 %. Lorsque la PaO₂ descend en dessous de 60 mm Hg, la saturation sanguine en oxygène peut chuter brutalement, entraînant une diminution significative de la teneur artérielle en oxygène et potentiellement une hypoxie tissulaire.
Outre l'hypoxémie artérielle, une supplémentation en oxygène peut s'avérer nécessaire dans de rares cas. En cas d'anémie sévère, de traumatisme ou de chirurgie critique, l'hypoxie tissulaire peut être réduite en augmentant le taux d'oxygène artériel. Chez les patients intoxiqués au monoxyde de carbone (CO), une supplémentation en oxygène peut augmenter la teneur en oxygène dissous dans le sang, remplacer le CO lié à l'hémoglobine et augmenter la proportion d'hémoglobine oxygénée. Après inhalation d'oxygène pur, la demi-vie de la carboxyhémoglobine est de 70 à 80 minutes, tandis qu'elle est de 320 minutes à l'air ambiant. Sous oxygène hyperbare, la demi-vie de la carboxyhémoglobine est réduite à moins de 10 minutes après inhalation d'oxygène pur. L'oxygène hyperbare est généralement utilisé en cas de taux élevés de carboxyhémoglobine (> 25 %), d'ischémie cardiaque ou d'anomalies sensorielles.
Malgré l'absence de données probantes ou l'inexactitude des données, d'autres pathologies peuvent également bénéficier d'une supplémentation en oxygène. L'oxygénothérapie est couramment utilisée pour les algies vasculaires de la face, les crises drépanocytaires, le soulagement de la détresse respiratoire sans hypoxémie, le pneumothorax et l'emphysème médiastinal (favorisant l'absorption d'air thoracique). Des données suggèrent qu'un apport élevé en oxygène peropératoire peut réduire l'incidence des infections du site opératoire. Cependant, la supplémentation en oxygène ne semble pas réduire efficacement les nausées et vomissements postopératoires.
Avec l'amélioration des capacités d'approvisionnement en oxygène en ambulatoire, le recours à l'oxygénothérapie de longue durée (OLD) est également en augmentation. Les normes de mise en œuvre de l'oxygénothérapie de longue durée sont déjà très claires. L'oxygénothérapie de longue durée est couramment utilisée dans le traitement de la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).
Deux études menées sur des patients atteints de BPCO hypoxémique fournissent des données à l'appui de l'oxygénothérapie de longue durée. La première étude, l'essai d'oxygénothérapie nocturne (NOTT), mené en 1980, consistait à répartir aléatoirement les patients entre une oxygénothérapie nocturne (au moins 12 heures) et une oxygénothérapie continue. À 12 et 24 mois, les patients recevant uniquement une oxygénothérapie nocturne présentaient un taux de mortalité plus élevé. La seconde expérience, l'essai familial du Medical Research Council, mené en 1981, consistait à répartir aléatoirement les patients en deux groupes : ceux ne recevant pas d'oxygène et ceux recevant de l'oxygène au moins 15 heures par jour. Comme pour le test NOTT, le taux de mortalité dans le groupe anaérobie était significativement plus élevé. Les sujets des deux essais étaient des patients non-fumeurs ayant reçu un traitement maximal et dont l'état était stable, avec une PaO2 inférieure à 55 mmHg, ou des patients atteints de polyglobulie ou de cardiopathie pulmonaire avec une PaO2 inférieure à 60 mmHg.
Ces deux expériences indiquent qu'une supplémentation en oxygène pendant plus de 15 heures par jour est préférable à une absence totale d'oxygène, et qu'une oxygénothérapie continue est préférable à un traitement uniquement nocturne. Les critères d'inclusion de ces essais servent de base aux compagnies d'assurance maladie et à l'ATS pour élaborer des recommandations concernant l'oxygénothérapie de longue durée. On peut raisonnablement en déduire que l'oxygénothérapie de longue durée est également acceptée pour d'autres maladies cardiovasculaires hypoxiques, mais les preuves expérimentales pertinentes font actuellement défaut. Un essai multicentrique récent n'a constaté aucune différence dans l'impact de l'oxygénothérapie sur la mortalité ou la qualité de vie des patients atteints de BPCO présentant une hypoxémie ne répondant pas aux critères de repos ou uniquement due à l'exercice.
Les médecins prescrivent parfois une supplémentation nocturne en oxygène aux patients présentant une baisse importante de la saturation sanguine en oxygène pendant leur sommeil. Il n'existe actuellement aucune preuve formelle de l'efficacité de cette approche chez les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil. Chez les patients souffrant d'apnée obstructive du sommeil ou d'un syndrome d'obésité-hypopnée entraînant une respiration nocturne difficile, la ventilation non invasive en pression positive (VPN) plutôt que la supplémentation en oxygène constitue le principal traitement.
Un autre point à considérer est la nécessité d'une supplémentation en oxygène pendant les voyages en avion. La plupart des avions commerciaux augmentent généralement la pression en cabine jusqu'à une altitude équivalente à 8 000 pieds, avec une pression d'oxygène inhalé d'environ 108 mm Hg. Chez les patients atteints de maladies pulmonaires, une diminution de la pression d'oxygène inhalé (PiO2) peut provoquer une hypoxémie. Avant le voyage, les patients doivent subir un examen médical complet, incluant une analyse des gaz du sang artériel. Si la PaO2 du patient au sol est ≥ 70 mm Hg (SpO2 > 95 %), sa PaO2 pendant le vol est susceptible de dépasser 50 mm Hg, ce qui est généralement considéré comme suffisant pour supporter une activité physique minimale. Pour les patients présentant une SpO2 ou une PaO2 basse, un test de marche de 6 minutes ou un test de simulation d'hypoxie peuvent être envisagés, respirant généralement 15 % d'oxygène. En cas d'hypoxémie pendant le voyage en avion, de l'oxygène peut être administré par canule nasale pour augmenter l'apport en oxygène.
Bases biochimiques de l'intoxication à l'oxygène
La toxicité de l'oxygène est due à la production d'espèces réactives de l'oxygène (ERO). Les ERO sont des radicaux libres dérivés de l'oxygène, possédant un électron orbital non apparié. Ils peuvent réagir avec les protéines, les lipides et les acides nucléiques, altérant leur structure et provoquant des lésions cellulaires. Lors du métabolisme mitochondrial normal, une petite quantité d'ERO est produite comme molécule de signalisation. Les cellules immunitaires utilisent également les ERO pour éliminer les agents pathogènes. Les ERO comprennent les radicaux superoxyde, peroxyde d'hydrogène (H₂O₂) et hydroxyles. Un excès d'ERO dépasse inévitablement les défenses cellulaires, entraînant la mort ou des lésions cellulaires.
Pour limiter les dommages induits par la production de ROS, le mécanisme de protection antioxydant des cellules peut neutraliser les radicaux libres. La superoxyde dismutase convertit le superoxyde en H₂O₂, qui est ensuite converti en H₂O et O₂ par la catalase et la glutathion peroxydase. Le glutathion est une molécule importante qui limite les dommages causés par les ROS. D'autres molécules antioxydantes comprennent l'alpha-tocophérol (vitamine E), l'acide ascorbique (vitamine C), les phospholipides et la cystéine. Le tissu pulmonaire humain contient de fortes concentrations d'antioxydants extracellulaires et d'isoenzymes de superoxyde dismutase, ce qui le rend moins toxique lorsqu'il est exposé à des concentrations plus élevées d'oxygène que d'autres tissus.
Les lésions pulmonaires induites par les ROS induites par l'hyperoxie peuvent être divisées en deux phases. La première est la phase exsudative, caractérisée par la mort des cellules épithéliales alvéolaires de type 1 et des cellules endothéliales, un œdème interstitiel et le remplissage des alvéoles par des neutrophiles exsudatifs. Vient ensuite la phase de prolifération, au cours de laquelle les cellules endothéliales et les cellules épithéliales de type 2 prolifèrent et recouvrent la membrane basale précédemment exposée. La période de récupération après lésion par l'oxygène se caractérise par une prolifération des fibroblastes et une fibrose interstitielle, mais l'endothélium capillaire et l'épithélium alvéolaire conservent un aspect à peu près normal.
Manifestations cliniques de la toxicité pulmonaire de l'oxygène
Le niveau d'exposition à partir duquel la toxicité se produit n'est pas encore clairement défini. Lorsque la FIO₂ est inférieure à 0,5, la toxicité clinique n'apparaît généralement pas. Des études antérieures chez l'humain ont montré qu'une exposition à près de 100 % d'oxygène peut provoquer des anomalies sensorielles, des nausées et des bronchites, ainsi qu'une réduction de la capacité pulmonaire, de la capacité de diffusion pulmonaire, de la compliance pulmonaire, de la PaO₂ et du pH. Parmi les autres problèmes liés à la toxicité de l'oxygène figurent l'atélectasie par absorption, l'hypercapnie induite par l'oxygène, le syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) et la dysplasie bronchopulmonaire néonatale (DBP).
Atélectasie absorbante. L'azote est un gaz inerte qui diffuse très lentement dans la circulation sanguine par rapport à l'oxygène, contribuant ainsi au maintien de l'expansion alvéolaire. En cas d'utilisation d'oxygène pur, le taux d'absorption d'oxygène étant supérieur au débit de gaz frais, une carence en azote peut entraîner un collapsus alvéolaire dans les zones où le rapport ventilation/perfusion alvéolaire (V/Q) est plus faible. En particulier pendant une intervention chirurgicale, l'anesthésie et la paralysie peuvent entraîner une diminution de la fonction pulmonaire résiduelle, favorisant le collapsus des petites voies aériennes et des alvéoles, entraînant ainsi une apparition rapide d'atélectasie.
Hypercapnie induite par l'oxygène. Les patients atteints de BPCO sévère sont sujets à une hypercapnie sévère lorsqu'ils sont exposés à de fortes concentrations d'oxygène lors de l'aggravation de leur état. Le mécanisme de cette hypercapnie réside dans l'inhibition de la capacité de l'hypoxémie à stimuler la respiration. Cependant, chez chaque patient, deux autres mécanismes interviennent à des degrés divers.
L'hypoxémie chez les patients atteints de BPCO résulte d'une faible pression partielle alvéolaire en oxygène (PAO2) dans la région à faible rapport V/Q. Afin de minimiser l'impact de ces régions à faible rapport V/Q sur l'hypoxémie, deux réactions de la circulation pulmonaire – la vasoconstriction pulmonaire hypoxique (VPH) et la vasoconstriction pulmonaire hypercapnique – transfèrent le flux sanguin vers des zones bien ventilées. Lorsque la supplémentation en oxygène augmente la PAO2, la VPH diminue significativement, augmentant la perfusion dans ces zones, ce qui entraîne des zones présentant des rapports V/Q plus faibles. Ces tissus pulmonaires sont désormais riches en oxygène, mais leur capacité à éliminer le CO2 est réduite. Cette perfusion accrue de ces tissus pulmonaires se fait au détriment des zones mieux ventilées, qui ne peuvent plus libérer de grandes quantités de CO2 comme auparavant, ce qui entraîne une hypercapnie.
Une autre raison est l'affaiblissement de l'effet Haldane, ce qui signifie que le sang désoxygéné peut transporter davantage de CO₂ que le sang oxygéné. Lorsque l'hémoglobine est désoxygénée, elle lie davantage de protons (H₂) et de CO₂ sous forme d'amino-esters. Lorsque la concentration de désoxyhémoglobine diminue pendant l'oxygénothérapie, le pouvoir tampon du CO₂ et de l'H₂ diminue également, ce qui affaiblit la capacité du sang veineux à transporter le CO₂ et entraîne une augmentation de la PaCO₂.
Lors de l'administration d'oxygène à des patients souffrant de rétention chronique de CO2 ou à haut risque, notamment en cas d'hypoxémie extrême, il est primordial d'ajuster finement la FIO2 afin de maintenir la SpO2 entre 88 et 90 %. De nombreux cas rapportés indiquent qu'une mauvaise régulation de l'O2 peut avoir des conséquences néfastes. Une étude randomisée menée auprès de patients présentant une exacerbation aiguë de PDCO lors de leur transfert à l'hôpital l'a incontestablement démontré. Comparativement aux patients sans restriction d'oxygène, les patients randomisés pour recevoir une supplémentation en oxygène afin de maintenir la SpO2 entre 88 et 92 % présentaient un taux de mortalité significativement plus faible (7 % contre 2 %).
SDRA et trouble borderline. On sait depuis longtemps que la toxicité de l'oxygène est associée à la physiopathologie du SDRA. Chez les mammifères non humains, une exposition à 100 % d'oxygène peut entraîner des lésions alvéolaires diffuses, voire mortelles. Cependant, il est difficile de distinguer précisément la toxicité de l'oxygène chez les patients atteints de maladies pulmonaires graves des lésions causées par des maladies sous-jacentes. De plus, de nombreuses maladies inflammatoires peuvent induire une régulation positive des défenses antioxydantes. Par conséquent, la plupart des études n'ont pas réussi à démontrer de corrélation entre une exposition excessive à l'oxygène et une lésion pulmonaire aiguë ou un SDRA.
La maladie des membranes hyalines pulmonaires est une maladie causée par un manque de substances tensioactives, caractérisée par un collapsus alvéolaire et une inflammation. Les nouveau-nés prématurés atteints de cette maladie nécessitent généralement l'inhalation de fortes concentrations d'oxygène. La toxicité de l'oxygène est considérée comme un facteur majeur dans la pathogenèse de la DBP, même chez les nouveau-nés ne nécessitant pas de ventilation mécanique. Les nouveau-nés sont particulièrement sensibles aux dommages causés par une forte oxygénation, car leurs fonctions de défense antioxydante cellulaire ne sont pas encore pleinement développées et matures. La rétinopathie du prématuré est une maladie associée à un stress hypoxique/hyperoxie répété, et cet effet a été confirmé dans la rétinopathie du prématuré.
L'effet synergique de la toxicité pulmonaire de l'oxygène
Plusieurs médicaments peuvent augmenter la toxicité de l'oxygène. L'oxygène augmente les ROS produits par la bléomycine et inactive la bléomycine hydrolase. Chez le hamster, une pression partielle d'oxygène élevée peut aggraver les lésions pulmonaires induites par la bléomycine, et des cas rapportés ont également décrit un SDRA chez des patients traités par bléomycine et exposés à une FIO₂ élevée pendant la période périopératoire. Cependant, un essai prospectif n'a pas démontré de lien entre une exposition à de fortes concentrations d'oxygène, une exposition antérieure à la bléomycine et un dysfonctionnement pulmonaire postopératoire sévère. Le paraquat est un herbicide commercial qui augmente également la toxicité de l'oxygène. Par conséquent, lors de la prise en charge des patients intoxiqués au paraquat et exposés à la bléomycine, la FIO₂ doit être réduite autant que possible. Parmi les autres médicaments susceptibles d'aggraver la toxicité de l'oxygène, on trouve le disulfirame et la nitrofurantoïne. Les carences en protéines et en nutriments peuvent entraîner des dommages importants à l’oxygène, qui peuvent être dus à un manque d’acides aminés contenant du thiol, essentiels à la synthèse du glutathion, ainsi qu’à un manque de vitamines antioxydantes A et E.
Toxicité de l'oxygène dans d'autres systèmes organiques
L'hyperoxie peut provoquer des réactions toxiques au niveau d'organes extra-pulmonaires. Une vaste étude de cohorte rétrospective multicentrique a montré une association entre une mortalité accrue et des taux d'oxygène élevés après une réanimation cardiorespiratoire (RCP) réussie. L'étude a révélé que les patients présentant une PaO2 supérieure à 300 mm Hg après RCP présentaient un risque relatif de mortalité intrahospitalière de 1,8 (IC à 95 %, 1,8-2,2) par rapport aux patients présentant une oxygénation sanguine normale ou une hypoxémie. Cette augmentation du taux de mortalité s'explique par la détérioration de la fonction du système nerveux central après un arrêt cardiaque causé par une lésion de reperfusion à haute teneur en oxygène médiée par les ROS. Une étude récente a également décrit une augmentation du taux de mortalité chez les patients hypoxémiques après intubation aux urgences, étroitement liée au degré d'élévation de la PaO2.
Chez les patients victimes de lésions cérébrales et d'AVC, l'apport d'oxygène à ceux qui ne présentent pas d'hypoxémie semble n'avoir aucun bénéfice. Une étude menée par un centre de traumatologie a révélé que, comparativement aux patients présentant un taux d'oxygène sanguin normal, les patients victimes de lésions cérébrales ayant reçu une oxygénothérapie élevée (PaO2 > 200 mm Hg) présentaient un taux de mortalité plus élevé et un score de coma de Glasgow plus faible à leur sortie. Une autre étude portant sur des patients recevant une oxygénothérapie hyperbare a montré un pronostic neurologique défavorable. Dans un vaste essai multicentrique, l'apport d'oxygène à des patients victimes d'AVC aigu sans hypoxémie (saturation supérieure à 96 %) n'a eu aucun effet bénéfique sur la mortalité ou le pronostic fonctionnel.
En cas d'infarctus aigu du myocarde (IAM), la supplémentation en oxygène est un traitement couramment utilisé, mais son intérêt pour ces patients reste controversé. L'oxygène est nécessaire dans le traitement des patients atteints d'infarctus aigu du myocarde et présentant une hypoxémie concomitante, car il peut sauver des vies. Cependant, les bénéfices de la supplémentation traditionnelle en oxygène en l'absence d'hypoxémie ne sont pas encore clairement établis. À la fin des années 1970, un essai randomisé en double aveugle a inclus 157 patients atteints d'un infarctus aigu du myocarde non compliqué et a comparé l'oxygénothérapie (6 L/min) à l'absence d'oxygénothérapie. Il a été constaté que les patients recevant une oxygénothérapie présentaient une incidence plus élevée de tachycardie sinusale et une augmentation plus importante des enzymes myocardiques, mais aucune différence n'a été observée en termes de taux de mortalité.
Chez les patients atteints d'un infarctus aigu du myocarde avec sus-décalage du segment ST sans hypoxémie, l'oxygénothérapie par canule nasale à 8 L/min n'est pas bénéfique par rapport à l'inhalation d'air ambiant. Dans une autre étude portant sur l'inhalation d'oxygène à 6 L/min et l'inhalation d'air ambiant, aucune différence n'a été observée en termes de mortalité et de taux de réadmission à un an chez les patients atteints d'un infarctus aigu du myocarde. Le contrôle de la saturation en oxygène du sang entre 98 % et 100 % et entre 90 % et 94 % n'apporte aucun bénéfice chez les patients en arrêt cardiaque hors de l'hôpital. Les effets potentiellement nocifs d'un apport élevé en oxygène sur l'infarctus aigu du myocarde comprennent la constriction des artères coronaires, une perturbation de la distribution du flux sanguin dans la microcirculation, une augmentation du shunt fonctionnel d'oxygène, une diminution de la consommation d'oxygène et une augmentation des lésions des ROS dans la zone de reperfusion réussie.
Enfin, des essais cliniques et des méta-analyses ont examiné les valeurs cibles de SpO2 appropriées pour les patients hospitalisés en état critique. Un essai randomisé ouvert, monocentrique, comparant l'oxygénothérapie conservatrice (cible de SpO2 de 94 % à 98 %) à la thérapie traditionnelle (valeur de SpO2 de 97 % à 100 %) a été mené sur 434 patients en unité de soins intensifs. Le taux de mortalité en unité de soins intensifs des patients randomisés pour recevoir une oxygénothérapie conservatrice s'est amélioré, avec des taux plus faibles de choc, d'insuffisance hépatique et de bactériémie. Une méta-analyse ultérieure a inclus 25 essais cliniques ayant recruté plus de 16 000 patients hospitalisés avec divers diagnostics, notamment un accident vasculaire cérébral, un traumatisme, une septicémie, un infarctus du myocarde et une intervention chirurgicale d'urgence. Les résultats de cette méta-analyse ont montré que les patients recevant des stratégies d'oxygénothérapie conservatrice présentaient un taux de mortalité intra-hospitalière accru (risque relatif, 1,21 ; IC à 95 %, 1,03-1,43).
Français Cependant, deux essais ultérieurs à grande échelle n'ont pas réussi à démontrer un quelconque impact des stratégies d'oxygénothérapie conservatrice sur le nombre de jours sans respirateur chez les patients atteints d'une maladie pulmonaire ou sur le taux de survie à 28 jours chez les patients atteints de SDRA. Récemment, une étude portant sur 2541 patients sous ventilation mécanique a révélé qu'une supplémentation en oxygène ciblée dans trois plages différentes de SpO2 (88 %~92 %, 92 %~96 %, 96 %~100 %) n'affectait pas les résultats tels que les jours de survie, la mortalité, l'arrêt cardiaque, l'arythmie, l'infarctus du myocarde, l'accident vasculaire cérébral ou le pneumothorax sans ventilation mécanique dans les 28 jours. Sur la base de ces données, les lignes directrices de la British Thoracic Society recommandent une plage cible de SpO2 de 94 % à 98 % pour la plupart des patients adultes hospitalisés. Cela est raisonnable car une SpO2 dans cette plage (en considérant l'erreur de ± 2 %~3 % des oxymètres de pouls) correspond à une plage de PaO2 de 65-100 mm Hg, ce qui est sûr et suffisant pour les niveaux d'oxygène dans le sang. Pour les patients à risque d’insuffisance respiratoire hypercapnique, 88 % à 92 % est un objectif plus sûr pour éviter l’hypercapnie causée par l’O2.
Date de publication : 13 juillet 2024