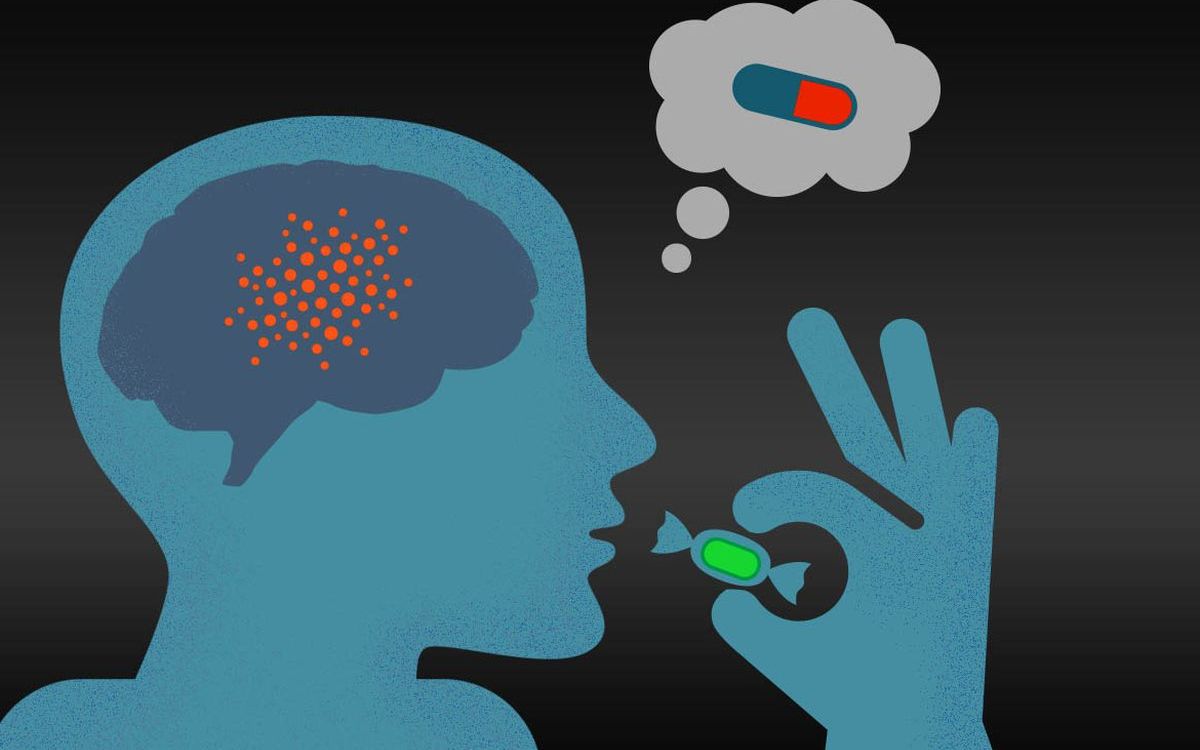L'effet placebo désigne la sensation d'amélioration de la santé ressentie suite à des attentes positives face à un traitement inefficace. L'effet anti-placebo, quant à lui, désigne la diminution de l'efficacité du traitement due à des attentes négatives, ou l'apparition d'effets secondaires liés à ces attentes, pouvant entraîner une aggravation de l'état de santé. Ces effets sont fréquents en clinique et en recherche, et peuvent affecter l'efficacité et les résultats thérapeutiques des patients.
L'effet placebo et l'effet anti-placebo sont les effets générés respectivement par les attentes positives et négatives des patients quant à leur propre état de santé. Ces effets peuvent survenir dans divers contextes cliniques, notamment lors de l'utilisation de médicaments actifs ou d'un placebo en pratique clinique ou lors d'essais cliniques, de l'obtention d'un consentement éclairé, de la fourniture d'informations médicales et de la conduite d'activités de promotion de la santé publique. L'effet placebo produit des résultats favorables, tandis que l'effet anti-placebo produit des résultats néfastes et dangereux.
Les différences de réponse au traitement et de présentation des symptômes entre les patients peuvent être en partie attribuées aux effets placebo et anti-placebo. En pratique clinique, la fréquence et l'intensité des effets placebo sont difficiles à déterminer, tandis qu'en conditions expérimentales, leur fréquence et leur intensité varient considérablement. Par exemple, dans de nombreux essais cliniques en double aveugle portant sur le traitement de la douleur ou des troubles mentaux, la réponse au placebo est similaire à celle aux médicaments actifs, et jusqu'à 19 % des adultes et 26 % des personnes âgées ayant reçu un placebo ont signalé des effets secondaires. De plus, lors des essais cliniques, jusqu'à un quart des patients ayant reçu un placebo ont arrêté leur traitement en raison d'effets secondaires, ce qui suggère que l'effet anti-placebo peut entraîner l'arrêt du traitement ou une mauvaise observance.
Les mécanismes neurobiologiques des effets placebo et anti-placebo
Il a été démontré que l'effet placebo est associé à la libération de nombreuses substances, telles que les opioïdes endogènes, les cannabinoïdes, la dopamine, l'ocytocine et la vasopressine. L'action de chaque substance cible le système (douleur, mouvement ou système immunitaire) et les maladies (comme l'arthrite ou la maladie de Parkinson). Par exemple, la libération de dopamine est impliquée dans l'effet placebo dans le traitement de la maladie de Parkinson, mais pas dans celui de la douleur chronique ou aiguë.
L'exacerbation de la douleur provoquée par la suggestion verbale dans l'expérience (effet anti-placebo) s'est avérée médiée par le neuropeptide cholécystokinine et peut être bloquée par le proglutamide (antagoniste des récepteurs de type A et B de la cholécystokinine). Chez les personnes saines, cette hyperalgésie induite par le langage est associée à une augmentation de l'activité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Le diazépam, une benzodiazépine, peut antagoniser l'hyperalgésie et l'hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, suggérant que l'anxiété est impliquée dans ces effets anti-placebo. Cependant, l'alanine peut bloquer l'hyperalgésie, mais pas l'hyperactivité de l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien, suggérant que le système cholécystokinine est impliqué dans la composante hyperalgésie de l'effet anti-placebo, mais pas dans la composante anxiété. L’influence de la génétique sur les effets placebo et anti-placebo est associée aux haplotypes de polymorphismes nucléotidiques simples dans les gènes de la dopamine, des opioïdes et des cannabinoïdes endogènes.
Une méta-analyse au niveau des participants de 20 études de neuroimagerie fonctionnelle portant sur 603 participants sains a montré que l'effet placebo associé à la douleur n'avait qu'un faible impact sur les manifestations d'imagerie fonctionnelle liées à la douleur (appelées signatures de douleur neurogène). L'effet placebo pourrait jouer un rôle à plusieurs niveaux des réseaux cérébraux, qui favorisent les émotions et leur impact sur les expériences subjectives multifactorielles de douleur. L'imagerie du cerveau et de la moelle épinière montre que l'effet anti-placebo entraîne une augmentation de la transmission du signal de douleur de la moelle épinière au cerveau. Dans l'expérience visant à tester la réponse des participants aux crèmes placebo, ces crèmes ont été décrites comme provoquant de la douleur et étiquetées comme étant chères ou peu coûteuses. Les résultats ont montré que les régions de transmission de la douleur dans le cerveau et la moelle épinière étaient activées lorsque les personnes s'attendaient à ressentir une douleur plus intense après avoir reçu un traitement avec des crèmes coûteuses. De même, certaines expériences ont testé la douleur induite par la chaleur qui peut être soulagée par le puissant médicament opioïde rémifentanil ; Parmi les participants qui pensaient que le rémifentanil avait été arrêté, l'hippocampe a été activé et l'effet anti placebo a bloqué l'efficacité du médicament, suggérant que le stress et la mémoire étaient impliqués dans cet effet.
Attentes, indices linguistiques et effets du cadre
Les événements moléculaires et les modifications du réseau neuronal qui sous-tendent les effets placebo et anti-placebo sont influencés par leurs résultats futurs attendus ou prévisibles. Si l'attente peut se réaliser, on parle d'attente ; les attentes peuvent être mesurées et influencées par des changements de perception et de cognition. Les attentes peuvent être générées de diverses manières, notamment par des expériences antérieures d'effets médicamenteux et d'effets secondaires (tels que les effets analgésiques après la prise d'un médicament), des instructions verbales (comme être informé qu'un médicament peut soulager la douleur) ou des observations sociales (comme l'observation directe du soulagement des symptômes chez d'autres personnes après la prise du même médicament). Cependant, certaines attentes et certains effets placebo et anti-placebo ne peuvent se réaliser. Par exemple, nous pouvons induire conditionnellement des réponses immunosuppressives chez des patients subissant une transplantation rénale. La méthode de preuve consiste à appliquer aux patients des stimuli neutres préalablement associés à des immunosuppresseurs. L'utilisation de stimulations neutres seules réduit également la prolifération des lymphocytes T.
En milieu clinique, les attentes sont influencées par la manière dont les médicaments sont décrits ou par le cadre utilisé. Après une intervention chirurgicale, contrairement à une administration masquée où le patient ignore l'heure d'administration, si le traitement administré pendant l'administration de morphine indique qu'il peut soulager efficacement la douleur, il apportera des bénéfices significatifs. Les signalements directs d'effets secondaires peuvent également être auto-satisfaisants. Une étude a inclus des patients traités par aténolol, un bêta-bloquant, pour des maladies cardiaques et de l'hypertension. Les résultats ont montré que l'incidence des effets secondaires sexuels et de la dysfonction érectile était de 31 % chez les patients informés intentionnellement des effets secondaires potentiels, contre seulement 16 % chez les patients non informés. De même, parmi les patients prenant du finastéride pour une hypertrophie bénigne de la prostate, 43 % des patients explicitement informés des effets secondaires sexuels en ont ressenti, contre 15 % chez les patients non informés. Une étude a inclus des patients asthmatiques qui ont inhalé une solution saline nébulisée et ont été informés qu'ils inhalaient des allergènes. Les résultats ont montré qu'environ la moitié des patients présentaient des difficultés respiratoires, une augmentation de la résistance des voies aériennes et une diminution de la capacité pulmonaire. Parmi les patients asthmatiques ayant inhalé des bronchoconstricteurs, ceux qui avaient été informés de l'existence de ces médicaments ont présenté une détresse respiratoire et une résistance des voies aériennes plus sévères que ceux qui avaient été informés de l'existence de bronchodilatateurs.
De plus, les attentes induites par le langage peuvent provoquer des symptômes spécifiques tels que douleur, démangeaisons et nausées. Après suggestion langagière, les stimuli liés à une douleur de faible intensité peuvent être perçus comme une douleur de forte intensité, tandis que les stimuli tactiles peuvent être perçus comme de la douleur. Outre l'induction ou l'exacerbation des symptômes, les attentes négatives peuvent également réduire l'efficacité des médicaments actifs. Si l'on transmet aux patients la fausse information selon laquelle le médicament exacerbera la douleur au lieu de la soulager, l'effet des analgésiques locaux peut être bloqué. Si le rizitriptan, agoniste des récepteurs de la 5-hydroxytryptamine, est étiqueté par erreur comme un placebo, son efficacité dans le traitement des crises de migraine peut être réduite ; de même, les attentes négatives peuvent également réduire l'effet analgésique des opioïdes sur la douleur induite expérimentalement.
Mécanismes d'apprentissage dans les effets placebo et anti-placebo
L'apprentissage et le conditionnement classique interviennent tous deux dans les effets placebo et antiplacebo. Dans de nombreuses situations cliniques, des stimuli neutres, précédemment associés aux effets bénéfiques ou nocifs des médicaments par le conditionnement classique, peuvent produire des effets bénéfiques ou secondaires sans recours ultérieur à des médicaments actifs.
Par exemple, si des signaux environnementaux ou gustatifs sont associés de manière répétée à la morphine, ces mêmes signaux utilisés avec un placebo au lieu de la morphine peuvent néanmoins produire des effets analgésiques. Chez les patients atteints de psoriasis ayant reçu une administration intermittente de glucocorticoïdes à dose réduite et de placebo (placebo à extension de dose), le taux de récidive du psoriasis était similaire à celui des patients recevant une corticothérapie à dose complète. Dans le groupe témoin de patients ayant reçu le même schéma de réduction des corticostéroïdes mais n'ayant pas reçu de placebo à intervalles réguliers, le taux de récidive était jusqu'à trois fois supérieur à celui du groupe placebo à dose continue. Des effets conditionnants similaires ont été rapportés dans le traitement de l'insomnie chronique et dans l'utilisation d'amphétamines chez les enfants atteints de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité.
Les expériences thérapeutiques antérieures et les mécanismes d'apprentissage influencent également l'effet antiplacebo. Parmi les femmes recevant une chimiothérapie pour un cancer du sein, 30 % d'entre elles s'attendaient à ressentir des nausées après avoir été exposées à des signaux environnementaux (comme venir à l'hôpital, rencontrer le personnel médical ou entrer dans une pièce similaire à la salle de perfusion) qui étaient neutres avant l'exposition, mais qui avaient été associés à la perfusion. Les nouveau-nés ayant subi des ponctions veineuses répétées présentent immédiatement des pleurs et des douleurs lors du nettoyage de leur peau à l'alcool avant la ponction. Montrer des allergènes dans des contenants scellés à des patients asthmatiques peut déclencher des crises d'asthme. Si un liquide à l'odeur spécifique, mais sans effets biologiques bénéfiques, a déjà été associé à un médicament actif ayant des effets secondaires importants (comme les antidépresseurs tricycliques), l'utilisation de ce liquide avec un placebo peut également induire des effets secondaires. Si des signaux visuels (tels que la lumière et les images) ont déjà été associés à une douleur induite expérimentalement, leur utilisation seule peut également induire une douleur à l'avenir.
Connaître l'expérience d'autrui peut également entraîner des effets placebo et anti-placebo. Le fait de constater un soulagement de la douleur chez autrui peut également induire un effet analgésique placebo, d'une ampleur similaire à l'effet analgésique ressenti par soi-même avant le traitement. Des données expérimentales suggèrent que l'environnement social et les manifestations peuvent induire des effets secondaires. Par exemple, si des participants voient d'autres personnes signaler les effets secondaires d'un placebo, signaler une douleur après l'utilisation d'une pommade inactive ou inhaler de l'air intérieur qualifié de « potentiellement toxique », cela peut également entraîner des effets secondaires chez les participants exposés au même placebo, à la même pommade inactive ou à l'air intérieur.
Les reportages des médias grand public et non professionnels, les informations obtenues sur Internet et le contact direct avec d'autres personnes symptomatiques peuvent tous favoriser la réaction anti-placebo. Par exemple, le taux de signalement des effets indésirables des statines est corrélé à l'intensité des signalements négatifs à leur égard. Un exemple particulièrement frappant est celui d'une multiplication par 2 000 du nombre d'événements indésirables signalés après que des reportages négatifs dans les médias et à la télévision ont mis en évidence des modifications nocives de la formule d'un médicament pour la thyroïde, ne concernant que les symptômes spécifiques mentionnés dans les signalements négatifs. De même, lorsque la promotion publique incite les habitants à croire à tort qu'ils sont exposés à des substances toxiques ou à des déchets dangereux, l'incidence des symptômes attribués à cette exposition imaginaire augmente.
L'impact des effets placebo et anti-placebo sur la recherche et la pratique clinique
Il pourrait être utile de déterminer qui est prédisposé aux effets placebo et anti-placebo en début de traitement. Certaines caractéristiques liées à ces réponses sont actuellement connues, mais des recherches futures pourraient fournir de meilleures preuves empiriques à leur sujet. L'optimisme et la susceptibilité à la suggestion ne semblent pas étroitement liés à la réponse au placebo. Des données suggèrent que l'effet anti-placebo est plus susceptible de se produire chez les patients plus anxieux, ayant déjà présenté des symptômes d'origine médicale inconnue ou présentant une détresse psychologique importante parmi ceux prenant des médicaments actifs. Il n'existe actuellement aucune preuve claire concernant le rôle du sexe dans les effets placebo ou anti-placebo. L'imagerie, le risque multigénique, les études d'association pangénomique et les études sur des jumeaux pourraient contribuer à élucider comment les mécanismes cérébraux et la génétique induisent des modifications biologiques à l'origine des effets placebo et anti-placebo.
L'interaction entre patients et médecins cliniciens peut influencer la probabilité d'effets placebo et les effets secondaires rapportés après l'administration d'un placebo et de médicaments actifs. Il a été démontré que la confiance des patients envers les médecins cliniciens et leur bonne relation, ainsi qu'une communication franche entre patients et médecins, soulagent les symptômes. Ainsi, les patients qui croient que les médecins sont empathiques et qui signalent des symptômes de rhume sont plus légers et de courte durée que ceux qui pensent que les médecins ne le sont pas ; les patients qui croient que les médecins sont empathiques constatent également une diminution des indicateurs objectifs d'inflammation, tels que l'interleukine-8 et le taux de neutrophiles. Les attentes positives des médecins cliniciens jouent également un rôle dans l'effet placebo. Une petite étude comparant les analgésiques anesthésiques et le traitement par placebo après une extraction dentaire a montré que les médecins étaient conscients que les patients recevant des analgésiques étaient associés à un meilleur soulagement de la douleur.
Si l'on souhaite utiliser l'effet placebo pour améliorer les résultats thérapeutiques sans adopter une approche paternaliste, une solution consiste à décrire le traitement de manière réaliste mais positive. Il a été démontré que susciter des attentes de bénéfices thérapeutiques améliore la réponse des patients à la morphine, au diazépam, à la stimulation cérébrale profonde, à l'administration intraveineuse de rémifentanil, à l'administration locale de lidocaïne, aux thérapies complémentaires et intégrées (comme l'acupuncture), et même à la chirurgie.
Étudier les attentes des patients constitue la première étape de leur intégration dans la pratique clinique. Lors de l'évaluation des résultats cliniques attendus, les patients peuvent être invités à utiliser une échelle de 0 (aucun bénéfice) à 100 (bénéfice maximal imaginable) pour évaluer les bénéfices thérapeutiques attendus. Aider les patients à comprendre leurs attentes concernant une chirurgie cardiaque programmée réduit l'invalidité à 6 mois postopératoires. Fournir des conseils sur les stratégies d'adaptation aux patients avant une chirurgie intra-abdominale a permis de réduire significativement la douleur postopératoire et la posologie des anesthésiques (de 50 %). Pour exploiter ces effets de cadre, il convient non seulement d'expliquer aux patients la pertinence du traitement, mais aussi la proportion de patients qui en bénéficient. Par exemple, insister sur l'efficacité des médicaments peut réduire le recours aux analgésiques postopératoires que les patients peuvent contrôler eux-mêmes.
En pratique clinique, il existe d'autres moyens éthiques d'exploiter l'effet placebo. Certaines études confirment l'efficacité de la méthode du placebo ouvert, qui consiste à administrer un placebo en même temps que le médicament actif et à informer honnêtement les patients que l'ajout d'un placebo a démontré son efficacité. De plus, il est possible de maintenir l'efficacité du médicament actif par un conditionnement tout en réduisant progressivement la dose. La méthode opératoire spécifique consiste à associer le médicament à des signaux sensoriels, ce qui est particulièrement utile pour les drogues toxiques ou addictives.
À l'inverse, des informations inquiétantes, des croyances erronées, des attentes pessimistes, des expériences passées négatives, des informations sociales et l'environnement thérapeutique peuvent entraîner des effets secondaires et réduire les bénéfices des traitements symptomatiques et palliatifs. Les effets secondaires non spécifiques des médicaments actifs (intermittents, hétérogènes, dose-dépendants et peu reproductibles) sont fréquents. Ces effets secondaires peuvent entraîner une mauvaise observance du plan de traitement (ou du plan d'arrêt) prescrit par le médecin, obligeant les patients à changer de médicament ou à en ajouter d'autres pour les traiter. Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour établir un lien clair entre les deux, ces effets secondaires non spécifiques pourraient être dus à l'effet anti-placebo.
Il peut être utile d'expliquer les effets secondaires au patient tout en soulignant les bénéfices. Il peut également être judicieux de les décrire de manière encourageante plutôt que trompeuse. Par exemple, expliquer aux patients la proportion de patients sans effets secondaires, plutôt que celle de patients avec, peut réduire l'incidence de ces effets.
Les médecins ont l'obligation d'obtenir le consentement éclairé valide de leurs patients avant de mettre en œuvre un traitement. Dans le cadre de ce processus, ils doivent fournir des informations complètes afin d'aider les patients à prendre des décisions éclairées. Ils doivent expliquer clairement et précisément tous les effets secondaires potentiellement dangereux et cliniquement significatifs, et informer les patients de la nécessité de les signaler. Cependant, énumérer un par un les effets secondaires bénins et non spécifiques qui ne nécessitent pas de soins médicaux augmente la probabilité de leur apparition, ce qui pose un dilemme aux médecins. Une solution possible consiste à présenter l'effet anti-placebo aux patients, puis à leur demander s'ils sont disposés à en apprendre davantage sur les effets secondaires bénins et non spécifiques du traitement après en avoir pris connaissance. Cette méthode est appelée « consentement éclairé contextualisé » et « examen autorisé ».
Il peut être utile d'explorer ces questions avec les patients, car des croyances erronées, des attentes inquiétantes et des expériences négatives avec des médicaments antérieurs peuvent entraîner un effet anti-placebo. Quels effets secondaires gênants ou dangereux ont-ils déjà eus ? Quels effets secondaires les inquiètent-ils ? S'ils souffrent actuellement d'effets secondaires bénins, quel impact pensent-ils avoir ? S'attendent-ils à ce que les effets secondaires s'aggravent avec le temps ? Les réponses des patients peuvent aider les médecins à apaiser leurs inquiétudes concernant les effets secondaires, rendant ainsi le traitement plus tolérable. Les médecins peuvent rassurer les patients sur le fait que, même si les effets secondaires peuvent être gênants, ils sont en réalité inoffensifs et sans danger médical, ce qui peut atténuer l'anxiété qui les déclenche. À l'inverse, si l'interaction entre les patients et les médecins cliniciens ne parvient pas à apaiser leur anxiété, voire à l'exacerber, elle amplifiera les effets secondaires. Une revue qualitative d'études expérimentales et cliniques suggère que les comportements non verbaux négatifs et les modes de communication indifférents (tels que le discours empathique, l'absence de contact visuel avec les patients, un discours monotone et l'absence de sourire) peuvent favoriser l'effet anti-placebo, réduire la tolérance du patient à la douleur et atténuer l'effet placebo. Les effets secondaires présumés sont souvent des symptômes auparavant négligés, mais désormais attribués au médicament. Corriger cette attribution erronée peut améliorer la tolérance du médicament.
Les effets secondaires rapportés par les patients peuvent être exprimés de manière non verbale et discrète, exprimant des doutes, des réserves ou une anxiété concernant le médicament, le plan de traitement ou les compétences professionnelles du médecin. Comparés à l'expression directe des doutes auprès des médecins cliniciens, les effets secondaires constituent un motif moins gênant et plus acceptable d'arrêt du traitement. Dans ces situations, clarifier et discuter franchement des inquiétudes du patient peut permettre d'éviter les situations d'arrêt ou de mauvaise observance.
La recherche sur les effets placebo et anti-placebo est importante pour la conception et la mise en œuvre des essais cliniques, ainsi que pour l'interprétation des résultats. Premièrement, lorsque cela est possible, les essais cliniques devraient inclure des groupes d'intervention sans intervention afin d'expliquer les facteurs de confusion associés aux effets placebo et anti-placebo, tels que la moyenne de régression des symptômes. Deuxièmement, la conception longitudinale de l'essai influencera l'incidence de la réponse au placebo, en particulier dans le cadre d'un essai croisé. En effet, les expériences positives antérieures des participants ayant reçu le médicament actif en premier susciteront des attentes, contrairement à celles des participants ayant reçu le placebo en premier. Étant donné qu'informer les patients des bénéfices et des effets secondaires spécifiques du traitement peut augmenter leur incidence, il est préférable de maintenir la cohérence des informations sur les bénéfices et les effets secondaires fournies lors du processus de consentement éclairé entre les essais étudiant un médicament spécifique. Dans une méta-analyse où les informations manquent de cohérence, les résultats doivent être interprétés avec prudence. Il est préférable que les chercheurs qui collectent des données sur les effets secondaires ignorent à la fois le groupe traité et la situation des effets secondaires. Pour recueillir des données sur les effets secondaires, une liste structurée de symptômes est préférable à une enquête ouverte.
Date de publication : 29 juin 2024